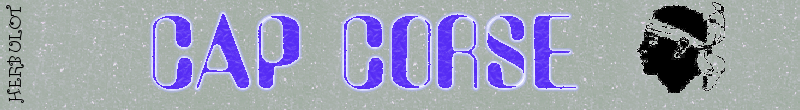
| Introduction | fiche technique | devis | cahiers techniques | plans | Glossaire | Articles de presse | liens |
![]()
|
|
|
LES MÉTHODES MODERNES DE CONSTRUCTION AMATEUR UN PEU D'HISTOIRE TECHNIQUE Un bateau peut se comparer à une cage thoracique : il comprend une échine, la quille ; des côtes, les membrures et les barrots ; une peau, le bordé. Les bateaux, depuis des millénaires, ont des coques à forme ronde. C'est peut-être la conséquence de l'emploi initial de troncs d'arbre creusés. C'est aussi le résultat d'une expérience également millénaire, que la science moderne a mise en formule : l'écoulement d'un fluide le long d'un solide est d'autant plus aisé que les formes de ce solide présentent moins d'irrégularités. Cependant, la forme arrondie des coques pose au constructeur des problèmes techniques délicats. En effet, une coque de bateau, comme une écorce d'orange ou la peau d'un mammifère, ne constitue pas une surface développable. Autrement dit, il serait impossible de la mettre à plat sans la distendre — comme on le fait pour les peaux — ou la découper en secteurs approximativement plats — comme on le fait pour l'orange. La technique classique, de ce fait, consiste à construire la coque en planches appelées virures, découpées en fuseaux, les extrémités (vers l'étrave et l'étambot) étant plus étroites que celles qui couvrent le milieu de la coque au maître-couple. Il s'agit là d'une méthode de construction lente, car chaque virure doit être ajustée sur la précédente, et délicate, car l'étanchéité du bateau dépend de cet ajustage. On avait bien trouvé une méthode pour tourner la difficulté : celle du bachot à fond plat bordé de planches à peu près verticales, la liaison entre les deux éléments de la coque se faisant à angle vif. Les Américains, les premiers ont utilisé ce procédé, en l'améliorant d'ailleurs, pour la construction de voiliers connus sous le nom de « Sharpies » (de Sharp : aigu). Trichant ainsi avec le problème, les Architectes Navals ont créé des bateaux fort marins, mais initialement moins élégants et parfois un peu moins rapides que les bateaux en forme de même échantillon. La généralisation du contreplaqué-marine, offrant de grandes surfaces d'épaisseur et de résistance régulières a permis de donner un essor prodigieux aux « Sharpies » en permettant parallèlement de réduire les prix de revient : les 15.000 propriétaires de Vaurien au 1 octobre 1965 ne nous contrediront pas sur ce point. Le contreplaqué cependant présente trop d'avantages — rapidité de mise en œuvre en particulier — pour que la SIBMA ne se soit pas attachée à mettre ce mode de construction à la disposition de ses clients. Parallèlement, les architectes navals ont affiné le dessin des coques à bouchain vif jusqu'à leur donner des caractéristiques telles que certains bateaux de ce type — le Fireball en particulier — soutiennent aisément la comparaison avec des bateaux de même catégorie et de classe internationale. En outre, l'architecte J.-J. Herbulot a, le premier, conçu des coques destinées à être réalisées en système mixte : les fonds et les francs-bords développables sont construits en contreplaqué ; le bouchain arrondi est réalisé en bois moulé. Cette méthode particulièrement intéressante pour l'amateur a été employée initialement pour le Flibustier. Elle est étendue désormais aux Maraudeur, Cap-Corse et Boucanier. Ainsi, la gamme des techniques offertes à l'amateur apparaît désormais aussi complète que celle des chantiers, construction traditionnelle mise à part. Francs-bords développables sont construits en contreplaqué ; le bouchain arrondi est réalisé en bois moulé. Cette méthode particulièrement intéressante pour l'amateur a été employée initialement pour le Flibustier. Elle est étendue désormais aux Maraudeur, Cap-Corse et Boucanier. Ainsi, la gamme des techniques offertes à l'amateur apparaît désormais aussi complète que celle des chantiers, construction traditionnelle mise à part. LE BOIS MOULÉ
Schématiquement, cette méthode consiste à utiliser un moule représentant les volumes intérieurs du bateau, pour fabriquer un contreplaqué « en forme », incapable par conséquent de se mettre à plat, qui constituera la coque du bateau. On emploie actuellement deux variétés de la technique de base : la construction à moule récupérable pour les petites unités et la construction à moule perdu ou sur lisses pour les bateaux plus importants (Cap Corse, Cap Horn, voire, en chantier exclusivement, Cap Vert). LA CONSTRUCTION A MOULE RÉCUPÉRABLE LE MOULE. — Celui-ci est constitué de deux longerons sur lesquels sont fixés d'équerre des couples de fortes planches. Les couples sont eux-mêmes recouverts par des lisses, lattes de sapin de 2 x 2 cm en général espacées, au maître-couple, de 8 à 10 cm. A l'avant et à l'arrière des pièces spéciales permettent de placer l'étrave et le tableau à la position exacte que ceux-ci doivent occuper. Enfin, des encoches assurent la mise en place de la quille, du brion et éventuellement du puits de dérive. LA CHARPENTE. — Le premier travail consiste à placer sur le moule l'ensemble étrave, brion, quille (éventuellement puits de dérive), tableau arrière et serre-bauquières. Ces éléments doivent, s'ils ne le sont pas encore, être équerrés ; ceci fait, on passe à la construction du bordé. LE BORDÉ. — C'est là en général la partie de construction qui inquiète le plus l'amateur. L'étanchéité du bordé est en effet essentielle et l'on craint souvent de ne pas le réussir. Or, l'expérience prouve qu'en bois moulé, le bordé est extrêmement facile à faire et que la méthode employée comme la qualité des colles rendent la coque parfaitement et définitivement étanche.
On utilise pour border la coque des lattes de 3 à 4 mm d'épaisseur selon la taille du bateau et de 8 à 10 cm de large. Ces lattes, d'acajou tranché, sont juxtaposées sur la coque pour former une première couverture ou « pli » incliné d'environ 45° sur l'axe de la quille, puis un second à 20° ou 150° du premier et un troisième fixé à angle voisin du premier. Ces plis successifs sont collés entre eux à l'aide de colles spéciales, mélamine-formol ou résorcine. La pression des agrafes tenant les lattes en place durant le séchage de la colle est suffisante pour faire passer la colle entre les lattes et les coller sur champ. Lorsque la coque est complètement terminée, on a donc un ensemble de contreplaqué en forme, solidement lié par des colles inattaquables à l'eau au même titre que celles du contreplaqué-marine. Bien entendu, étant donné le caractère non développable d'une coque en forme, les lattes doivent être légèrement ajustées. Un procédé très simple, n'exigeant rien d'autre qu'un crayon et un petit rabot permet de faire cet ajustage avec une facilité déconcertante. DÉMOULAGE ET AMÉNAGEMENTS. — La coque terminée est poncée : on la retourne pour y placer les aménagements prévus sur le plan. Des croquis de détail permettent de réaliser ce travail sans risque d'erreur. Un certain nombre de pièces de profil délicat, barrots, consoles de bancs, etc. sont d'ailleurs livrées prédécoupées LA CONSTRUCTION A MOULE PERDU Au lieu de louer un moule préfabriqué, l'amateur, dans cette formule, doit le construire, car une partie importante du moule est constituée par les aménagements mêmes du bateau. Utilisant les plans grandeur nature du kit, l'amateur fixe les cloisons définitives sur le chantier de montage, aux emplacements prévus par le plan. Il les complète, aux emplacements également indiqués, par des gabarits provisoires et habille le tout des lisses qui resteront incorporées à la coque. Le reste du travail (bordé, démoulage, aménagements) ne diffère pas de la construction à moule récupérable. LE CONTREPLAQUÉ Les modèles retenus se construisent à moule perdu : après avoir fixé sur le chantier les membrures, l'amateur place sur celles-ci la quille, avec étrave et tableau, les quilles de bouchain et les bauquières. Certains bateaux enfin se construisent « en l'air », c'est-à-dire sans installation d'un chantier. En ce qui concerne les quilles de bouchain, on remarque que leur section varie de l'arrière à l'avant, les côtés du bateau étant presque perpendiculaires aux fonds à l'arrière, alors qu'à proximité de l'étrave, fonds et côtés sont presque dans le prolongement les uns des autres. Les quilles de bouchain présentent donc une section à angle variable. Réaliser cette variation continue au rabot est évidemment difficile. C'est pourquoi la SIBMA fournit les quilles de bouchain préalablement équerrées mécaniquement. Nous avons dit plus haut que le bordage de la coque présentait certaines difficultés techniques pour l'amateur, en raison notamment de la nervosité du contreplaqué. L'emploi cependant de certains artifices par l'architecte, ou du pré façonnage à l'échelon de la SIBMA permet à celle-ci de faire bénéficier les amateurs de la rapidité de construction qu'assure le contreplaqué. LA CONSTRUCTION MIXTE
Employée initialement pour le Maraudeur, cette méthode est étendue actuellement au Cap Corse et au Boucanier. 'BANANE1' Les fonds et les côtés ont été étudiés de telle sorte qu'ils constituent des surfaces développables. On peut donc les réaliser en contreplaqué. Le bouchain, non développable, est réalisé en bois moulé. Pour le Maraudeur, l'architecte, reprenant la technique qu'ont inventé les Vikings et qui a été conservée pour les embarcations légères de construction traditionnelle, a prévu une « banane » bordée à clins. La banane recouvre les fonds de quelques centimètres et est elle-même recouverte par le bordé des côtés. Cette méthode évite des assemblages délicats entre les panneaux de fond et ceux des côtés et conserve la grande rapidité de construction que permet le contreplaqué. Lorsque l'on passe à des bateaux de plus fort échantillon, Cap Corse par exemple, le problème se complique quelque peu. Ployer une feuille de contreplaqué de 9 mm, et par conséquent fort nerveuse, excède en général les moyens matériels dont dispose un amateur. Ici encore, une solution pratique et originale a été trouvée. On place d'abord un premier pli constitué de contre-plaqué de 5 mm et d'une banane analogue à celle du Maraudeur, à ceci près que la banane est bordée à franc-bord et non plus à clin. Pardessus ce premier « pli », on en place un second selon la technique du bois moulé décrite ci-dessus. De cette façon, on évite de manipuler du contreplaqué trop rigide, tout en donnant à la coque l'épaisseur nécessaire, en lui conservant l'élégante apparence que donne le bois moulé et en camouflant s'il y a lieu, les petites irrégularités qui peuvent survenir dans l'ajustage de la banane et du contreplaqué |